
« Vaincre en mer au XXIème siècle, la tactique au cinquième âge du combat naval » de Thibault Lavernhe et François-Olivier Corman est un livre qui tombe à pic. Lorsqu’il le lit, un ancien marin qui a passé plusieurs décennies à pratiquer les opérations en mer ou à réfléchir à l’hypothèse du combat naval se demande – avec une pointe d’amertume – pourquoi un tel livre n’a pas été écrit plus tôt. Est-ce à cause du tempo opérationnel croissant depuis 40 ans ? ou de la surcharge administrative qui a paradoxalement suivit la même tendance ? par paresse intellectuelle ? par esprit de conformisme ou crainte de l’hétérodoxie ? par une vision techniciste qui privilégie la connaissance des équipements sur les fondamentaux tactiques ?
La réponse est plutôt liée à l’époque : ce livre répond à un besoin urgent de l’Europe et de la France qui doivent se préparer aux conflits qui s’annoncent. Nous vivons en effet la fin d’une bulle stratégique où l’emploi des armées se limitait à une forme de « maintien de l’ordre » international, qui certes comportait des risques, mais plaçait nos forces dans une posture du Fort au Faible, finalement assez confortable. Sur mer, où la technologie règne et les outils s’appuient le plus souvent sur la puissance des Etats, cette supériorité était encore plus sensible. Pourquoi se poser la question de la meilleure façon de vaincre en mer si l’hypothèse de l’échec était exclue ?
Ce temps de facilité est derrière nous : de nombreuses puissances rivales ou antagonistes disposent aujourd’hui des moyens de s’opposer victorieusement aux forces navales européennes et françaises. Pour gagner le prochain combat naval, dont la probabilité s’accroît, nous devrons tirer le meilleur de nos forces en mer et donc redécouvrir les règles qui permettent d’optimiser leur emploi face à l’ennemi.
C’est l’objet de ce livre, unique en son genre en France alors que la littérature anglo-saxonne est très riche en la matière. Les auteurs, marins d’expérience, s’appuient sur leur connaissance des opérations actuelles pour passer au crible la théorie tactique. Ils ont fait un triple choix, particulièrement pertinent :
Le choix de la rigueur méthodologique d’abord, qui s’appuie sur la précision analytique et la recherche de l’exhaustivité, permettant au lecteur néophyte de suivre le raisonnement pas à pas et de s’approprier la problématique et les concepts qui régentent le combat naval. L’ouvrage présente ainsi les caractéristiques d’un manuel de tactique navale, consultable notamment par les professionnels aguerris en recherche de réflexion.
Le choix de la richesse bibliographique ensuite, nourrie de cartes, de schémas et de tableaux, qui rend compte de la diversité des analyses de ce domaine complexe. Il est intéressant à ce sujet d’observer le déséquilibre existant depuis un siècle entre la réflexion américaine – et dans une moindre mesure britannique – et son homologue française. La culture maritime de ces deux pays insulaires (presque insulaire pour ce qui concerne les Etats-Unis), ainsi que l’impact de la guerre des Malouines pour la Royal Navy en sont certainement les causes principales, mais la liberté d’expression des opérationnels et l’aptitude de l’institution militaire à accepter les remises en cause internes sont également déterminantes dans la vivacité conceptuelle de ces deux marines.
Le choix de la comparaison historique enfin, qui met en évidence les permanences du combat naval, en dépit de la forte dépendance de celui-ci aux évolutions technologiques. Dépassant la querelle des écoles Historique et Matérielle, « Vaincre en mer au XXIème siècle » est un remarquable livre d’histoire maritime appliquée, qui trie avec succès les aspects conjoncturels et les fondamentaux tactiques qui ont déterminé les victoires et les défaites sur mer pour les mettre en regard des réalités opérationnelles d’aujourd’hui.
Au cœur de l’ouvrage, le quatrième chapitre consacré aux principes de la tactique navale est essentiel pour comprendre les spécificités du combat en mer et ses différences d’avec le combat sur terre. Sur mer les engagements sont brefs et destinés à détruire des navires toujours longs à être remplacés, ce qui les rend le plus souvent décisifs. L’océan est ainsi une forme de ring, à la fois unique, grand et encombré, où les adversaires s’observent et évoluent en sachant que le premier coup sera potentiellement mortel. L’évaluation des forces en présence et donc de la détection et de la localisation de l’adversaire sont par conséquent déterminants. La prise de conscience de sa vulnérabilité oblige le Faible à tenter de jouer de la manœuvre et de la surprise pour affaiblir le Fort en évitant l’affrontement direct qu’il est certain de perdre. En mer la prime est au fort, à l’attaquant et à l’initiative. Ici, pas de victoire à la Pyrrhus comme ce fut le cas à la Moskova, au Viêt-Nam ou en Afghanistan : les vainqueurs de Trafalgar, de Tsushima, ou du Jutland deviennent les maîtres du ring et interdisent à leur opposant de l’utiliser librement. Ce qui n’est cependant pas toujours suffisant, gardons-le en mémoire, pour gagner la guerre.
Ce livre ne nous fera pas forcément gagner la guerre sur mer, mais il aidera certainement ceux qui la préparent et qui la conduiront à être en mesure de le faire. La réflexion conceptuelle qu’il inspire mérite d’être poursuivie et approfondie.
P.A.

Le Pont de la Victoire – L’Iran dans la Seconde Guerre mondiale, Christian et Pierre Pahlavi, Perrin, 2023, 491 p., 25 €
Il est rare qu’un récit historique éclaire avec autant d’acuité une problématique géopolitique actuelle. C’est pourtant l’exploit auquel sont parvenus Christian et Pierre Pahlavi dans leur nouvel opus consacré à l’étude de l’Iran contemporain. Après avoir décrypté les dessous de la révolution iranienne de 1979 dans leur Marécage des ayatollahs (Perrin, 2015), les Pahlavi père et fils explorent avec force détails le rôle méconnu, mais stratégique de l’Iran pendant la Seconde Guerre mondiale. Car ce vaste pays de montagne est situé au carrefour stratégique d’un axe nord-sud permettant aux Alliés de ravitailler l’Union soviétique par voie routière et ferroviaire à partir de 1941 – d’où le titre du livre faisant écho à la formule de Winston Churchill qui considérait l’Iran comme le « pont de sa victoire » – et d’un axe ouest-est reliant l’Europe, l’Asie mineure et l’Inde. Pour les Britanniques, l’Iran constitue une gigantesque réserve de pétrole, une forteresse naturelle empêchant les Allemands d’accéder aux hydrocarbures du Moyen-Orient via la Turquie ou le Caucase et une digue permettant d’endiguer les ambitions russes au sud tout en protégeant la route des Indes, vitale pour leur effort de guerre. Pour les Soviétiques, l’Iran reste une ligne de vie cruciale qui permet d’acheminer chez eux une masse considérable de matériels livrés par les Britanniques, puis les Américains (150 000 véhicules dont 12 000 chars, 2 100 chasseurs, 1 400 bombardiers, des stocks colossaux de munitions, d’essence raffinée, d’acier et d’aluminium), tenant ainsi en échec la Wehrmacht nazie. C’est surtout un espace offrant à Staline une profondeur stratégique au sud de l’URSS et un débouché sur l’océan Indien. Le Chah Reza Pahlavi s’est donc rapidement retrouvé écartelé entre sa volonté d’indépendance, son arrogance, ses sympathies allemandes (dont Berlin ne l’a pas payé en retour), et les intérêts vitaux du Royaume Uni et de l’Union soviétique. Comme il n’a pas saisi à temps les perches tendues par Churchill et Staline, les Britanniques et les Soviétiques envahissent son royaume qu’ils occupent en une semaine (25-31 août 1941), poussant le Chah à abdiquer en faveur de son fils Mohammed Reza. Soviétiques, Britanniques et Américains feront ensuite de l’Iran un pivot de leur effort pour combattre l’Allemagne nazie ; c’est d’ailleurs à Téhéran – nid d’espions – qu’ils s’entendront en novembre 1943 sur la grande stratégie conduisant à leur victoire finale. Les Iraniens – notamment ceux qui restent aux manettes aujourd’hui – n’oublieront jamais qu’ils ont été envahis et occupés pendant quatre ans par des Britanniques qu’ils détestent cordialement, par des Américains qu’ils critiquent mais qu’ils envient, et par des Russes dont ils se méfient viscéralement. Reza Pahlavi, exilé à l’île Maurice, décèdera finalement en Afrique du Sud en juillet 1944, surveillé par un surintendant britannique, seul et oublié de tous. Une fin de vie à la Bonaparte.
Mais revenons à la situation actuelle. Les débats stratégiques (avec qui s’allier pour quels bénéfices ? Comment rester réellement indépendant ?) et l’arrogance du pouvoir iranien rappellent furieusement ceux qui opposaient le Chah (le Guide aujourd’hui) aux différentes factions impériales au début de la Seconde Guerre mondiale. Les Russes sont toujours dans le paysage et offrent une alternative à l’activisme des Chinois et des Occidentaux tout en laissant entrevoir une profondeur stratégique ; ils rêvent d’accéder aux mers chaudes et peuvent fournir de l’armement de dernière génération ; l’Iran peut les aider à sécuriser leur flanc Sud. Les Européens restent une belle opportunité commerciale, mais tatillonne et sans réelle vision stratégique. Les Chinois endossent un peu le rôle des Britanniques à l’époque : l’acteur potentiellement le plus influent qui offre le plus de débouchés commerciaux, mais celui dont il ne faut pas tomber sous la coupe. Les Etats-Unis restent la référence qui séduit la population, comme l’Allemagne séduisait à l’époque l’élite iranienne.
Certains esprits chagrins pourraient contester l’objectivité d’un neveu et d’un petit-neveu du dernier Chah d’Iran à décortiquer ces évènements, leur reprochant de vouloir rédiger un plaidoyer pro domo. Il n’en est pourtant rien et cet ouvrage intelligent, passionnant et très bien écrit respecte tous les canons d’un livre d’histoire de première classe. Les sources sont variées et impressionnantes, la bibliographie exhaustive, l’Index impeccable. Tout juste peut-on regretter l’absence d’une chronologie synthétique et d’un cahier photographique, même si l’on comprend la réticence des éditeurs à accroître ainsi le coût de fabrication des ouvrages.
Au bilan, Le Pont de la Victoire est un ouvrage très agréable à lire, incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’Iran et souhaitent mieux comprendre la mentalité de son peuple et de ses dirigeants. Bref, une belle réussite !
P. R.

« Conduire la guerre : Entretiens sur l’art opératif », de Benoist Bihan et Jean Lopez, Perrin, Paris, 2023, 395 p, 22,90€.
« Conduire la guerre : entretiens sur l’art opératif » est un ouvrage original qui nous est proposé par Benoist Bihan et Jean Lopez. Né d’échanges électroniques entre les auteurs durant la pandémie de la Covid-19, ce travail de grande qualité, publié aux éditions Perrin en janvier 2023, éclaire le lecteur quant à la notion d’art opératif, trop souvent confondue avec stratégie et tactique. Benoist Bihan, en sa qualité d’historien militaire et chercheur en études stratégiques répond brillamment aux questions de Jean Lopez, fin connaisseur de la Seconde Guerre mondiale et directeur de rédaction de la revue Guerres & Histoire.
Ce duo retrace à travers 7 chapitres les guerres qui ont marquées l’histoire de l’Antiquité jusqu’à l’Ukraine en 2022, tout en gardant un avis critique sur les stratégies mises en œuvre. Sous forme de questions-réponses, l’art opératif reste le fil conducteur de l’ouvrage. C’est Alexandre Sviétchine, l’auteur de Strategiia, qui dès 1926 conceptualise l’art opératif. L’œuvre de ce militaire soviétique est étudiée sous toutes ses coutures permettant de théoriser et de décomposer les phases d’une guerre appliquée à l’art opératif : opérations permettant d’atteindre des buts intermédiaires pour atteindre le but ultime fixé par la stratégie.
Dans la lignée de la pensée de Carl Von Clausewitz, les deux auteurs évoquent l’importance de définir une stratégie qui doit, pour atteindre son but, combiner et harmoniser les actions du Souverain et du Stratège. En somme, le Souverain doit donner une direction politique au Stratège qui s’efforce de développer une ligne de conduite stratégique pour atteindre le but fixé par la stratégie. L’art opératif serait une manière de penser la guerre pour organiser les combats de façon pragmatique au service de la stratégie, en harmonie avec la volonté politique et l’usage de la tactique.
À travers de nombreuses exemples qui se sont déroulés au cours de la Seconde Guerre mondiale, Jean Lopez amène Benoist Bihan à exposer sa vision du développement de l’art opératif sous l’ère soviétique. L’opération Uranus de novembre 1942 et la bataille de Koursk de l’été 1943 participent à expliquer ce développement. Des contre-exemples sont toutefois amenés, tel l’ouverture aérienne de l’opération Barbarossa par les Allemands. Plus tard, l’échec de l’URSS en Afghanistan, permettra aussi de nuancer la capacité de maîtrise de l’art opératif par les Soviétiques.
Côté occidental, une critique constructive des auteurs défend l’idée que nul n’aurait réussi à développer l’art opératif. Les guerres du Vietnam, d’Afghanistan ou d’Irak sont utilisées pour démontrer cette idée, arguant l’inadéquation des enjeux politiques aux stratégies édictées. Les auteurs concèdent tout de même au camp occidental (et plus particulièrement aux Etats-Unis) des moments « clausewitziens », citant l’opération Desert Storm en tête, qui conduira à la libération du Koweït en 1991.
En somme, cet ouvrage apporte au lecteur une vision claire de ce que doit être la conduite d’une guerre. Convenant parfaitement aux adeptes de stratégie et d’histoire militaire, l’équipe Bihan-Lopez dépeint parfaitement les rouages parfois grippés des stratégies, bien souvent en pertes de sens, que l’on peut facilement transposer au contexte géopolitique actuel. Le théâtre ukrainien actuel et plus particulièrement la pratique du combat aéroterrestre qui y est faite trouve un écho à l’art opératif tel qu’il est décrit par les auteurs. Cet ouvrage apporte indéniablement sa contribution à la réflexion stratégique.
B.G
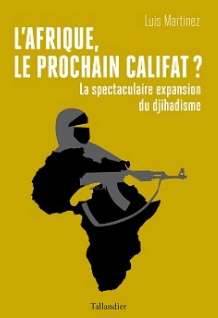
« L’Afrique, le prochain califat ? La spectaculaire expansion du djihadisme », de Luis Martinez, Tallandier, Paris, 2023, 237p, 20€.
Dans cet ouvrage original, Luis Martinez met à profit la soixantaine de missions qu’il a réalisées au Sahel et en Afrique de l’Ouest afin de nous faire part de son analyse sur l’extrémisme violent dans cette région. A la suite de l’échec de l’Etat islamique au Moyen-Orient, le Sahel représente une « zone de refuge ou de repli » pour certains groupes djihadistes qui ont tiré des leçons de la Syrie et de l’Irak. L’auteur affirme que toutes les conditions pour une emprise durable sont réunies : des conditions socio-économiques désastreuses (avec une grande partie de la population en dessous du seuil de pauvreté), des bouleversements géopolitiques propices (en particulier la désintégration de la Libye) et la faiblesse des Etats (qui ne peuvent pas garantir leur gouvernance sur l’ensemble de leur territoire, comme au Mali et au Burkina Faso).
Luis Martinez décrypte ensuite le mode d’expansion des groupes djihadistes ; leur propagande vise en général des groupes marginaux, qui ont développé le sentiment d’avoir été abandonnés par l’Etat. Ces groupes armés se présentent ainsi comme une alternative, en leur apportant des ressources tout en adoptant un discours anticolonialiste et antiétatique. La jeunesse est particulièrement visée car considérée comme influençable par son manque d’éducation. Leur moyen d’action principal reste néanmoins la terreur : ils effraient la population et instaurent un climat de terreur par des chantages et massacres répétés.
En 2022, la France a quitté le Mali après une décennie de présence militaire, ce qui selon l’auteur marque l’échec de l’opération Barkhane (destinée à lutter contre le terrorisme). Bien que le gouvernement malien l’ait appelée à l’aide, un sentiment anti-français s’est développé, et les ressentiments de l’époque coloniale ont ressurgi. La politique française de non-négociation avec les terroristes semble elle-même remise en question par les dirigeants au Sahel.
Le Mali a choisi plus récemment de se tourner vers l’Algérie, qui constituerait un « formidable relais » d’après la Turquie et la Russie. Cette dernière grandit son influence grâce aux milices Wagner mobilisées de manière exponentielle par les gouvernements sahéliens. La vision positive des Russes pourrait cependant être compromise par la guerre en Ukraine, qui contredit le discours anticolonialiste de la Russie. La Chine, quant à elle, s’impose sur le continent africain avec son « esprit gagnant-gagnant » sur le plan économique. La question Ouïgours reste cependant un bémol, car elle fait des Chinois un « ennemi de l’Islam » aux yeux des djihadistes.
Luis Martinez suggère enfin des pistes de solution pour contrer l’expansion djihadiste au Sahel : l’amélioration des conditions socio-économiques, une meilleure gouvernance, une lutte contre la discrimination des communautés, une sensibilisation des populations à la lutte contre le djihad et la promotion du vivre ensemble. L’auteur encourage les investissements, bien qu’il ait conscience que la situation sécuritaire ne soit pas des plus convaincantes pour les investisseurs. Il met également en garde contre les aides financières de l’Union européenne, qui doivent être mieux contrôlées (à cause des problèmes de corruption) et mieux prendre en compte la réalité du terrain.
L.F.